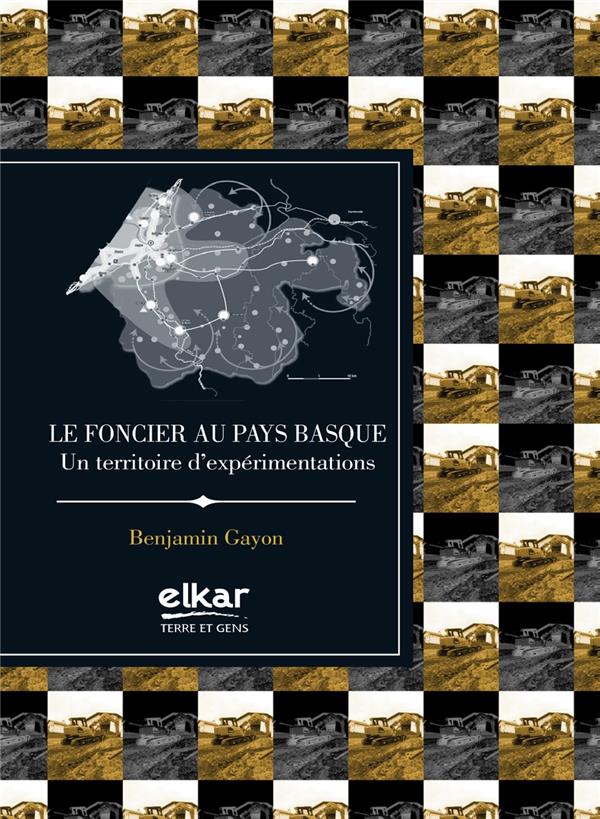
Dans la perspective des élections municipales de 2026, Enbata propose une série d’entretiens qui vise à fournir aux candidats des futures listes abertzale une boîte à idées, des pistes, des expériences, pour bâtir leurs programmes.
Ce mois-ci, Benjamin Gagnon, docteur en Aménagement de l’espace et urbanisme, auteur de “Le foncier au Pays basque. Un territoire d’expérimentations”.
Quel est l’enjeu de la consommation foncière à l’échelle communale et communautaire ?
La consommation foncière, qui se poursuit au Pays Basque (1), est le reflet d’une économie de production de la ville qui reste très linéaire. L’appropriation et la transformation d’une ressource naturelle non renouvelable (le foncier agricole ou naturel) fournit des biens à haute valeur économique sur les marchés (terrains constructibles, pour des produits immobiliers ou des activités économiques) générant des profits significatifs pour leurs propriétaires. Ce mode de production entraîne une expansion constante du tissu urbain depuis la côte vers les espaces rétro-littoraux, avec des coûts associés qui sont assumés par la puissance publique : développement de réseaux (eau, assainissement, électricité, fibre, transport…) et d’équipements (scolaires, sportifs, médicaux, commerciaux…). L’enjeu est d’intégrer à cette logique d’autres valeurs que la seule valeur économique : comme d’autres ressources, le sol est une ressource finie et sa préservation sera déterminante pour les générations futures. Il a une valeur environnementale, agricole, paysagère, sanitaire, et même culturelle, qui nous impose une plus grande sobriété.
Quelle pratique mettre en place immédiatement à l’échelle communale ?
Une commune peut mieux mobiliser les espaces déjà artificialisés et le bâti déjà existant : en privilégiant la résidence principale (via les outils fiscaux ou réglementaires), en facilitant la rénovation, la densification et la mixité des fonctions dans les opérations prévues sur la commune.
« À l’heure où l’ambition de Zéro artificialisation nette (ZAN)
est en plein détricotage à l’échelon national,
le prochain mandat communautaire peut démontrer
que l’échelon local est le plus adapté
pour investir cet objectif. «
Pour maîtriser davantage son développement futur, elle peut mettre en place une politique à moyen/long terme d’acquisition foncière sur des zones stratégiques, en mobilisant les outils de préemption et d’expropriation par elle-même ou par les acteurs délégataires (EPFL, SAFER…). Enfin, intégrer l’enjeu de sobriété foncière dans les documents de planification (PLUi, SCoT) se joue à l’échelle intercommunale : cela nécessite une participation active des élu⋅es communaux à la conception de ces documents et aux instances de décision dédiées.
Quel chantier animer durant le mandat ?
Celui de l’appropriation de ces enjeux par les habitant⋅es, et du débat collectif autour des politiques foncières et d’aménagement en général. Il y a une forte dimension culturelle dans notre manière d’appréhender les enjeux fonciers : il faut donc débattre collectivement de la nécessité de la densification de nos centres-villes et centre-bourgs ; des formes urbaines plus compactes que la maison individuelle et que les habitant⋅es seraient prêt⋅es à accepter ; faire prendre conscience des « services rendus » et de la valeur des sols, autrement que comme simple supports de projets de construction ou que matière première à l’urbanisation… C’est tout un imaginaire collectif qui est à réinvestir, en y intégrant d’autres échelles de valeur.
Quel projet/orientation appuyer à l’échelle communautaire ?
À l’heure où l’ambition de Zéro artificialisation nette (ZAN) est en plein détricotage à l’échelon national, le prochain mandat communautaire peut démontrer que l’échelon local est le plus adapté pour investir cet objectif. Les élu⋅es de la CAPB peuvent se fixer des objectifs de réduction forte de la consommation foncière tout en prenant en compte la diversité des territoires. Dans l’espace urbain côtier et rétro-littoral : préserver les espaces naturels et continuités écologiques qui persistent (notamment les zones humides), voire reconquérir des fonciers en friche. Dans les espaces ruraux : maintenir une capacité de développement pour les communes qui peinent à répondre à des demandes d’installation de nouveaux ménages à des prix abordables, tout en prenant en compte la valeur agronomique des sols dans les choix d’artificialisation. Faire d’un « ZAN Pays Basque » la concrétisation d’une véritable politique concertée de solidarité territoriale et de rééquilibrage.
Un dernier mot pour sensibiliser l’électeur sur l’importance de prendre en compte ces paramètres au moment de faire un choix éclairé pour les élections municipales ?
Une ambition assumée de réduction de la consommation foncière, c’est à la fois la preuve d’une volonté de rupture par rapport aux politiques publiques des dernières décennies, la démonstration d’une vision du développement qui intègre d’autres valeurs que le seul profit, et l’affirmation que la puissance publique à l’échelle locale dispose des outils suffisants pour avoir un réel impact.
(1) Voir des éléments de diagnostic dans les dernières publications du ScoT

