Opinion
Ur eskasari egokitu beharko
Gure ingurune berde eta hezean ere ur eskasaren fenomenoa gero eta usuago gertatzekotan da.
Testuinguru kezkagarri horrek bai eta ureztatzearen gaia ez dela gaurkoa jakiteak, geroari buruz zer ureztatu eta zer urekin irizpideak argitzeko premia argi uzten dute. (...)


 par
par 
 par
par 
 par
par 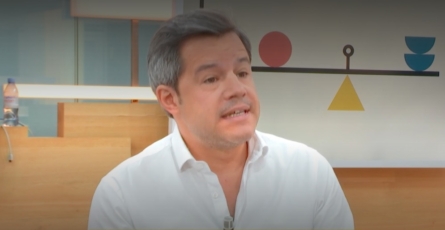
 par
par 
 par
par 

 par
par 
 par
par 
 par
par